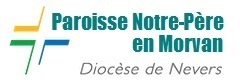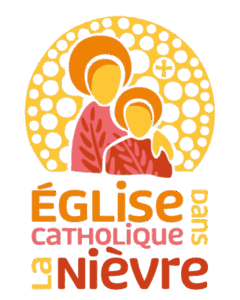Chapelle de Faubouloin (Histoire)
Découvrez l'histoire de la chapelle de Faubouloin au travers du texte affiché dans la clairière.
UN ÉDIFICE
Perdue au milieu des bois, dans un cadre impressionnant qui oppose l’accueillante foret à la vallée sauvage, la chapelle se dresse sur un éperon rocheux, au terme d’un plateau faiblement ondulé entre 500 et 550 mètres. Elle domine de plus de 70 mètres la naissance de l’OUSSIÈRE, à la réunion de la Montagne et de la REINACHE. Juste en face, sur la commune de LAVAULT DE FRÉTOY, s’étend un retranchement d’époque celtique, l’éperon barre de Verdun.
Bien que de construction et silhouette rustiques, le bâtiment orienté nord-est sud-ouest sur 20 mètres de long et presque 7 mètres de large s’affirme avec élégance. Un clocheton qui domine le toit, à deux pans, recouvert d’ardoises déclare la vocation religieuse.
L’apparente régularité extérieure dissimule des différences évidentes de l’intérieur. Le secteur nord-est, qui englobe l’autel long de 6m50, est constitué de murs épais d’un mètre, avec un léger rentrant interne qui figure séparation du reste de l’édifice. Il constitue vraisemblablement la partie la plus ancienne de la chapelle. Sur la face est, une fenêtre et une porte latérale en plein cintre, avec encadrement de granit taillé ne manquent pas d’allure. Le reste du bâtiment consiste en un mur épais de 60 centimètres environ, avec sur chaque côté une fenêtre plus simple, et au sud-ouest la porte principale également en plein cintre et du même type que précédemment. Elle porte la date de 1558 et fixe un remaniement important à cette époque.
Même si le détail nous échappe, nous constatons que la chapelle a connu de nombreux remaniements. Ainsi un coup d’œil permet de déceler une fenêtre murée dans le chevet, derrière l’autel. Même si la chapelle est très antérieure à l’érection du marquisat de La Tournelle en 1680, il est possible que ce fut l’occasion de restaurer ou d’installer le clocheton qui fournissait le cinquième clocher du marquisat. Dans sa monographie, JEAN SIMON, assure qu’en 1856 l’intérieur n’était pas pave. Il fixe à 1881 le pavage et la réfection de la toiture. A l’entrée de la partie nef, vers le chœur, une dalle ressemble fort à une ancienne pierre d’autel. Un enduit de plâtre assure le plafond. On remarquera au-dessus de l’autel une statue polychrome de Notre-Dame.
UN SITE : LES TROIS FONTAINES ET LE RITUEL
Autour de la chapelle, c’est le site immédiat avec les deux antiques tilleuls, qui a été inscrite à l’inventaire en 1943. Mais la dévotion et le rituel s’attachent traditionnellement aux trois célèbres fontaines : Sainte-Marie ou Notre-Dame, Sainte-Marguerite et du Frêne.
La confusion des témoignages écrits et oraux mêle quelque peu leurs vertus respectives et les pratiques observées.
À Sainte-Marie, dans la pente de la proche de la chapelle, les mères d’enfants malades consultaient l’oracle. Si le petit vêlement, bonnet ou chemise jeté à. l’eau surnageait, la guérison était proche. S’il coulait, il annonçait une mort rapide. Les femmes sollicitaient égaiement la protection des animaux domestiques, au moyen d’une modeste offrande, un gâteau de cire et de miel pour rappeler les abeilles en fuite, un peu de laine pour guérir les ouailles de leurs maux.
À Sainte-Marguerite, on attribue parfois la même vertu de guérir les animaux, outre la guérison des « bitoux » et des « bavous ». On ne peut oublier, que, d’une manière générale, la sainte passait pour assurer une heureuse délivrance aux femmes enceintes.
Tout le monde reconnaît la prééminence de la fontaine du Frêne, vraisemblablement la plus efficace ; dont le seul nom nous ramène à l’horizon des croyances celtiques, avec le culte de l’eau, de l’arbre et de la pierre. Elle doit guérir toutes les maladies, y compris les précédentes. Elle garantit le mariage pour les jeunes files, voire la fécondité des femmes. Il suffisait de boire de l’eau et de planter une épingle ou même une feuille de houx, parfois un clou dans le frêne.
Dans les temps de calamités météorologiques, quand l’excès d’eau ou -au contraire la sécheresse menaçaient les récoltes ou empêchaient les travaux agricoles, on venait en pèlerinage demander le changement. Et le rituel imposait, au moins pour les gens d’ASNOST, d’asperger copieusement leur curé au passage de la rivière, rite comparable à celui de Notre-Dame du Regard a la Petite Verrière, ou a l’immersion de la statue de Saint-Mamert dans le crot du Las à Saint-Hilaire. Tout ce la dénotant une vieille pratique de fécondité.
ORIGINE, LÉGENDAIRE et AUDIENCE
Le rituel et le culte pré chrétien, au moins celtique, lentement christianisé au profit de Notre-Dame expliquent le double nom des lieux, plus chrétiennement Notre-Dame de Grace de Faubouloin, plus populairement et familièrement Notre-Dame du Frêne.
Une grande abondance de légendes supplée poétiquement à l’insuffisance de nos sources sur 'évolution du culte. Outre l’âne de Saint-Martin qui aurait bondi du sommet du Mont Fromage jusqu’au milieu de l‘oppidum de Verdun, juste en face, nous retrouvons les thèmes classiques de l‘édification de la chapelle ; nombreuses versions ce la découverte d'une statue de Notre-Dame dans l’arbre sacré ; nombreuses versions du choix du site par le jet du marteau ; légendes diverses sur la conservation des coutumes et le maintien de la statue dans son sanctuaire.
Les deux pèlerinages traditionnels, le lundi de Pâques et le jour de la nativité de Notre-Darne, le 8 septembre voyaient la population des paroisses voisines, CHAUMARD, CHÂTIN, CHÂTEAU-CHINON, SAINT-HILAIRE, MHÈRE, PLANCHEZ, … se joindre à celle de CORANCY.
Mais en cas de calamité, on venait de très loin, particulièrement de l'Est du Morvan d'ANOST, CUSSY, LA VERRIÈRE, ROUSSILLON, RECLESNE, … là où on retrouve encore trace du « Grand chemin de Faubouloin ». Ceux qui venaient de loin arrivaient la veille et passaient la nuit sur place.
Ainsi, Faubouloin fut l’un de nos grands sanctuaires régionaux, en continuité depuis l’époque celtique, sinon pré celtique.
Et si aujourd’hui la nécessité a fait déplacer le pèlerinage au 15 août, le jour de l’Assomption, l’édifice et l’antique croyance méritent toute l’attention des contemporains.
La chapelle, longtemps propriété des descendants du dernier propriétaire du marquisat de la Tournelle, l’Intendant de Moulins, FOULON DE DOUÉ, est passé par don, en 1986, à la commune de CORANCY, où elle bénéficie de l’attention de la Municipalité et des habitants avec l’appui d’une association de sauvegarde.
Depuis 1984, l’Association de Sauvegarde aide la commune pour l’entretien et la mise en valeur de ce patrimoine, dont le siège social est à la : MAIRIE DE CORANCY 58120